Très bon article sur le Covid 19
publié dans regards sur le monde le 24 octobre 2020
Aldo Maria Valli vient de publier un petit livre (petit par la taille, mais grand par le sujet) dont le thème est « le despotisme étatique en temps de pandémie, qui menace la démocratie libérale » (*). Il le présente ici dans la rubrique hebdomadaire La trave e la pagliuzza (« La poutre et la paille ») qu’il tient sur Radio Roma libera. C’est une formidable réflexion sur ce que nous sommes en train de vivre.
Aldo Maria Valli cite le célèbre ouvrage de Tocqueville « De la démocratie en Amérique« , j’ai recherché le texte auquel il se réfère en français, on le trouvera en Annexe . Un texte qui lui aussi donne beaucoup à réfléchir
(*) Pour ceux qui lisent l’italien, le livre est disponible sur Amazon.fr qui annonce un délai de livraison très court et un prix de 11€ (eh oui… et ce n’est pas de la pub!).

Virus et Léviathan. Voilà comment nous perdons notre liberté. Même celle de penser.
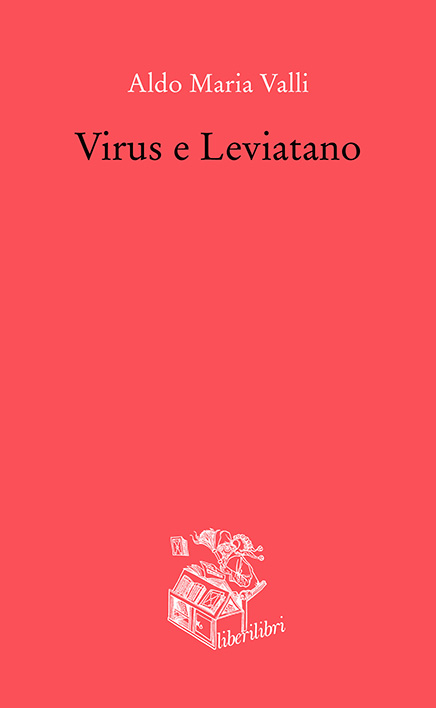
Un despotisme étatiste, partagé et thérapeutique. C’est le genre de régime dans lequel nous nous trouvons plongés, comme je l’ai écrit dans mon dernier livre, le court essai « Virus e Léviatano« , depuis que nous luttons contre le coronavirus.
Pourquoi ai-je parlé de despotisme étatique, partagé et thérapeutique ?
Avec la pandémie, les procédures constitutionnelles habituelles ont été suspendues et nous avons cessé d’être une République parlementaire. L’instrument des décrets de la présidence du Conseil a acquis une centralité et une prééminence absolues.
C’est comme si tout le monde (politiciens et citoyens), face à un stress test, avait proclamé que les droits constitutionnels de liberté et de parlementarisme sont des luxes que nous pouvons nous permettre quand tout va bien, mais pas face à une grave difficulté.
En voyant avec quelle désinvolture le gouvernement a suspendu les droits de liberté, et avec quel naturel l’opinion publique a tout accepté, un ennemi de la liberté peut en avoir tiré des leçons utiles : il a été démontré qu’il est très facile de suspendre les garanties constitutionnelles et de donner au système un tournant dans un sens autoritaire.
Si la situation d’urgence devait s’étendre jusqu’à ce qu’elle soit présentée et perçue comme normale, que se passerait-il ? Qui peut nous assurer qu’un danger ne pourrait pas être créé délibérément à l’avenir ? Y a-t-il un risque que l’état d’urgence soit institutionnalisé ?
Il est certain que notre système démocratique libéral a été profondément blessé, mais peu de gens réagissent.
Je parle de despotisme parce que le gouvernement a assumé une centralité sans précédent. Mais de quel type de despotisme s’agit-il ?
C’est un despotisme partagé, car l’opinion publique et les médias l’ont justifié, l’ont pris en compte et l’ont fait leur. Ainsi, dans un certain sens, le Léviathan de Hobbes est revenu à la vie, ce colosse autoritaire qui contrôle tout en échange de la sécurité que les individus croient ne pas pouvoir se donner.
C’est aussi un despotisme étatiste car tout a été laissé à l’initiative de l’État : l’initiative privée et les organismes intermédiaires n’ont même pas été pris en considération. L’État est perçu comme une institution non seulement et non pas tant gestionnaire que salvatrice.
Il s’agit ensuite d’un despotisme thérapeutique, car la santé est devenue un absolu, le politicien a pris la forme d’un médecin, le citoyen est devenu un patient et la nation un hôpital. D’où une relation asymétrique qui favorise le despotisme lui-même : non plus la relation entre homme politique et citoyen, entre représentant et représenté, mais précisément la relation médecin-patient (qui met le patient dans l’état de ne pas discuter).
En arrière-plan, on trouve le dogmatisme scientifique, selon lequel « la science l’a dit » devient synonyme de vérité absolue. Mais on ne tient pas compte du fait que la science, en réalité, n’a jamais certaines réponses. La science ne peut qu’étudier, comparer, analyser les données. Obtenir certaines réponses de la science est une illusion.
Ce despotisme étatiste, partagé et thérapeutique révèle paradoxalement de nombreuses faiblesses. Faiblesse de la politique, qui s’est mise entre les mains de la technoscience, se reconnaissant incapable d’affronter les problèmes. Faiblesse de l’exécutif qui a été pris au dépourvu et est devenu autoritaire dans sa tentative de redressement. Faiblesse de l’État, qui a réagi avec la confusion habituelle et s’est laissé commander par des instances supranationales. Faiblesse de la société dite civile, complètement passive. Faiblesse de l’Eglise, qui s’est rapidement alignée sur le despotisme et le récit dominant. De façon générale, faiblesse anthropologique de l’homme contemporain, qui prétend être à l’abri de toute forme de contagion et qui est poussé à demander une protection, ignorant qu’il a en lui les réponses pour réagir.
J’ajoute que c’est un despotisme paternaliste, car il répète qu’il le fait pour notre bien, mais en fait il se comporte de manière autoritaire.
Le rôle de l’information est décisif. Ce despotisme, pour exister et s’affirmer, a besoin du soutien actif des médias, appelés à alimenter un récit basé sur la terreur. C’est la peur qui justifie le recours au despotisme, et la peur doit être entretenue, répandue. Le lien entre le despotisme partagé et l’information est très étroit et nécessaire.
Grâce à la peur, le citoyen (qui est devenu patient) peut seulement se laisser guider. La naissance, en pleine pandémie, d’une task force gouvernementale contre les fake news est significative. Dans une démocratie libérale, ce sont les citoyens qui se font une idée du problème grâce à la libre confrontation des sources et des opinions. Dans ce cas, au contraire, le gouvernement a prétendu établir lui-même ce qui est la vérité et ce qui est un mensonge, ce qui est une information vraie et ce qui ne l’est pas, quelles nouvelles et interprétations méritent d’être diffusées et ce qu’il faut arrêter.
Biopolitique et bioinformation vont de pair dans le domaine du despotisme paternaliste.
Aldous Huxley, dans son roman dystopique Le Meilleur des Mondes, imaginait que le conditionnement se faisait la nuit, pendant que les sujets dormaient, par l’administration d’un certain type de messages. Aujourd’hui, le conditionnement a lieu devant la télévision au moment des informations.
Un récit approprié peut pousser un peuple entier à se suicider par peur de mourir. C’est ce que nous sommes en train de voir.
Ce n’est pas l’ampleur réelle du danger qui importe, mais l’ampleur perçue. Ce n’est pas ce qui est, mais ce que les gens pensent qui est, en fonction du récit qui leur est imposé.
Renaud Girard, dans Le Figaro, a écrit : « Les sociologues devront analyser avec soin le rôle joué par les médias dans la création d’une psychose mondiale face à une maladie peu létale ». Dans l’espoir que nous serons encore libres de conduire ces analyses.
Une autre contagion s’est développée parallèlement à celle du coronavirus, et elle est bien plus dangereuse : la contagion de la panique.
Sous beaucoup d’aspects, c’est comme si nous avions vécu une révolution socialiste classique. Nous avons eu l’Idéal suprême (la santé), transformé en un absolu par rapport auquel tout est sacrifiable. Nous avons eu la terreur comme arme. Nous avons eu le récit approprié pour ce but. Nous avons les gardiens de la révolution, tous les citoyens « responsables », soldats prêts même à la dénonciation. Nous avons eu l’attaque contre l’Église. Avec la nouveauté que l’Eglise, au lieu de résister, s’est adaptée, se montrant encore plus royaliste que le roi. Prévisible, étant donné que l’Église ne met plus Dieu mais l’homme au centre, non pas le salut de l’âme mais la santé psychophysique.
Le mot « responsabilité » est devenu le drapeau de l’armée qui lutte pour se libérer du virus. Celui qui ne s’adapte pas est irresponsable, c’est l’ennemi. Les ba,deroles des balcons (« Tout ira bien ») ressemblent aux slogans des murs de La Havane : Venceremos, Hasta la victoria siempre.
Chaque révolution a ses slogans. Dans notre cas, en plus du mot « responsabilité », voici « Santé, Sécurité, Collaboration ».
Pour l’Église, c’était et c’est encore une grande occasion manquée. L’Église aurait pu enfin nous parler de la mort, du péché originel, de la signification de la souffrance et du mal. Elle a choisi de devenir l’Église d’État. Elle a parlé comme le gouvernement. Elle s’est concentrée sur les procédures d’assainissement et non sur le chemin de la sainteté. Elle était encore plus terrifiée que le reste de l’opinion publique. Elle a transformé ses prêtres en masques grotesques et la célébration eucharistique en une parodie blasphématoire, avec du désinfectant au centre de l’autel, comme nouvel objet d’adoration. L’Église n’a pas résisté au récit fondé sur la terreur. Elle s’est adaptée et a collaboré. Elle n’a pas dénoncé l’atteinte à la liberté religieuse et à la liberté de culte : elle s’est montrée anxieuse de se faire limiter et contrôler. L’épouse du Christ a tourné le dos à son Seigneur et a rejoint le scientisme, se laissant obséder par le mythe de l’hygiénisation. Elle a pris soin d’expliquer ce que Dieu ne peut pas faire. Elle s’est bien gardée d’offrir au Seigneur l’occasion d’accomplir un miracle.
Nous avons vécu dans le conformisme absolu, qui se réalise lorsque celui qui perd sa liberté ne le réalise même pas, parce qu’il est auto-asservi. Ainsi, le pouvoir n’a même plus besoin d’élever la voix. Plus sa puissance est totale, plus son commandement est muet. Juste un signe de tête. Nous ne pensons pas. Nous sommes ce que l’on nous dit d’être. Nous sommes maintenant amenés à croire que nous n’avons besoin que de ce qui nous est imposé. Le soupçon que nous avons perdu notre liberté ne nous touche même pas, car le conformisme n’est plus ressenti comme tel mais passe pour un grand sens des responsabilités.
Curieux : au moment même où l’Eglise a déserté, voilà que nous sont imposés des modèles religieux. Nous avons une Trinité (Science, Santé, Sécurité), nous avons le péché (ne pas collaborer, ne pas montrer de responsabilité), nous avons la punition (être littéralement excommunié, mis hors de la communauté comme indigne, si nous n’acceptons pas le récit dominant), nous avons les écritures sacrées (les mass media alignés), Nous avons la demande urgente de conversion (à la technoscience), nous avons l’identification de la croyance avec le salut, nous avons les nouveaux bâtons qui jugent tout et tous et qui mettent hors de l’assemblée civile les quelques personnes qui ne veulent pas s’aligner, considérées comme mécréants.
Notre culture sécularisée, une fois la ratio abandonnée, est tombée dans le fidéisme. Pour ne pas dire dans la superstition.
Sur tout, il faut le répéter, domine la peur. Une peur qui fait perdre la tête. Qui fait accepter le sacrifice de la liberté. Qui fait vivre le conformisme absolu comme une action cathartique.
Le Léviathan nous a soumis en utilisant la terreur. Nous avons oublié que l’exercice du pouvoir dans un système démocratique libéral est soumis à la loi et que plus d’une dictature est arrivée au pouvoir après avoir obtenu un consentement basé sur ce qui avait été fait passer pour de bonnes intentions.
Notre système a déjà les moyens de concilier le respect de l’État de droit et l’urgence (le décret-loi en est un exemple), mais une autre voie a été suivie.
La réserve de loi [dans la constitution italienne, ndt] est ainsi appelée parce qu’elle réserve au droit primaire, à l’exclusion des sources secondaires, la réglementation d’une certaine matière. Il s’agit d’une fonction de garantie : elle veut assurer que dans les matières particulièrement délicates, comme dans le cas des droits fondamentaux du citoyen, les décisions sont prises par l’organe le plus représentatif du pouvoir souverain, c’est-à-dire le Parlement, comme le prévoit l’article 70 de la Constitution, selon lequel la fonction législative est exercée par les deux Chambres. Aucune mesure restreignant les libertés fondamentales ne peut être prise en passant outre les prérogatives parlementaires. Mais tout a été balayé par le récit de la terreur.
Nous avons même oublié que l’État reçoit le pouvoir du peuple, que ce n’est pas le peuple qui obtient des concessions de l’État. Nous avons oublié que tout est permis, sauf ce qui est expressément interdit, tout n’est pas permis sauf ce qui est expressément autorisé.
Le prix que nous payons est et sera très élevé à tous points de vue : économique, social, psychologique.
On tente de nous faire vivre non plus dans un État de droit, mais dans un État policier, dans un État d’exception permanent. Nous sommes confrontés, il faut le dire, à une tentative subversive. Progressivement, les garanties constitutionnelles seront de plus en plus considérées comme des charges inutiles. Et qu’est-ce qui nous empêchera de procéder à des adaptations qui faussent complètement le système démocratique libéral, en se concentrant peut-être encore sur la santé ? Nous constatons déjà que l’État policier commence à envisager la possibilité d’entrer par effraction dans nos maisons, tout en insistant sur la dénonciation. Comme dans les pays d’Europe de l’Est avant la chute du Mur.
Alexis de Tocqueville, analysant le pouvoir, notamment administratif, aux États-Unis qu’il a visités et étudiés au début du XIXe siècle, l’a défini en utilisant cinq adjectifs : « Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux ». Il me semble que c’est l’image de ce que nous avons sous les yeux. La conséquence de ce type de pouvoir, observe Tocqueville, est que l’État tente de maintenir ses citoyens dans une situation infantile permanente. L’État s’occupe d’eux, les prend en charge, leur enlève « la fatigue de devoir penser » [cf. Annexe].
De « petites règles compliquées, méticuleuses et uniformes » ne semblent pas constituer un danger pour la démocratie libérale, mais inexorablement elles amolissent, plient, dirigent. Le peuple devient une masse informe, désireuse seulement de se laisser guider. Ce type d’État n’est pas le tyran classique qui fait la grosse voix et menace. Non, c’est presque gentil. Mais (j’utilise toujours les expressions de Tocqueville) « il gêne, il comprime, il énerve, il éteint, il hébète, et il réduit enfin chaque nation à n’être plus qu’un troupeau d’animaux timides et industrieux, dont le gouvernement est le berger» [ibid].
Le despotisme administratif n’est pas un signe de la force de l’État, mais un aveu de sa faiblesse. Comme le pouvoir central n’est pas sûr de lui mais qu’il est faible, incertain, perdu, il prétend ici tout réglementer. Lorsque, comme dans le cas italien actuel, le chef du gouvernement est un homme politique qui n’a même pas été élu par le peuple, son sentiment intime d’insécurité est encore plus accentué. D’où une plus grande charge despotique, visant à légitimer un mandat que le chef sait n’avoir jamais reçu.
Annexe
« Je veux imaginer sous quels traits nouveaux le despotisme pourrait se produire dans le monde : je vois une foule innombrable d’hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme. Chacun d’eux, retiré à l’écart, est comme étranger à la destinée de tous les autres : ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l’espèce humaine ; quant au demeurant de ses concitoyens, il est à côté d’eux, mais il ne les voit pas ; il les touche et ne les sent point ; il n’existe qu’en lui-même et pour lui seul, et, s’il lui reste encore une famille, on peut dire du moins qu’il n’a plus de patrie.
.
Au-dessus de ceux-là s’élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d’assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l’âge viril ; mais il ne cherche, au contraire, qu’à les fixer irrévocablement dans l’enfance ; il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu’ils ne songent qu’à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur ; mais il veut en être l’unique agent et le seul arbitre ; il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leurs successions, divise leurs héritages, que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre?.
C’est ainsi que tous les jours il rend moins utile et plus rare l’emploi du libre arbitre ; qu’il renferme l’action de la volonté dans un plus petit espace, et dérobe peu à peu à chaque citoyen jusqu’à l’usage de lui-même. L’égalité a préparé les hommes à toutes ces choses ; elle les a disposés à les souffrir et souvent même à les regarder comme un bienfait.
Après avoir pris ainsi tour à tour dans ses puissantes mains chaque individu et l’avoir pétri à sa guise, le souverain étend ses bras sur la société tout entière ; il en couvre la surface d’un réseau de petites règles compliquées, minutieuses et uniformes, à travers lesquelles les esprits les plus originaux et les âmes les plus vigoureuses ne sauraient se faire jour pour dépasser la foule ; il ne brise pas les volontés mais il les amollit, les plie et les dirige ; il force rarement d’agir, mais il s’oppose sans cesse à ce qu’on agisse ; il ne détruit point, il empêche de naître ; il ne tyrannise point, il gêne, il comprime, il énerve, il éteint, il hébète, et il réduit enfin chaque nation à n’être plus qu’un troupeau d’animaux timides et industrieux, dont le gouvernement est le berger. »
*Tocqueville, De la démocratie en Amérique, t. II, IVe partie, Chap. VI










